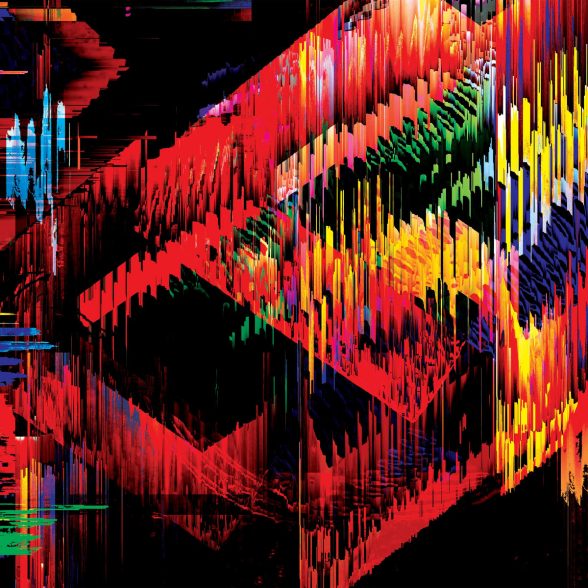
Ride
Interplay
- Wichita Recordings
- 2024
- 59 minutes
Depuis son retour en 2014 après presque 20 ans d’absence, le groupe shoegaze Ride a su résister à la tentation d’essayer de faire revivre le passé. Avec leur septième album en carrière, et troisième depuis leur reformation, les gars d’Oxford font un virage vers la synth-pop et la new wave des années 1980 sans renier complètement leurs racines non plus. Le résultat est énergique et assez efficace dans l’ensemble.
Après le très réussi Weather Diaries en 2017, la bande menée par les guitaristes et chanteurs Andy Bell et Mark Gardener m’avait laissé sur ma faim en 2019 avec This Is Not a Safe Place, qui poursuivait dans le même style plus pop que son prédécesseur, mais en moins inspiré, et avec des textes parfois bâclés. On y sentait aussi un groupe un peu écartelé entre le passé et le présent, désireux d’explorer de nouveaux horizons musicaux, mais tout en faisant plaisir à ses fans de la première heure.
Cette impression est moins présente sur Interplay, sur lequel les guitares rutilantes et nappées d’effets distordus qui ont fait la renommée de Ride au début des années 1990 prennent moins d’importance. Il y a bien l’épique Essaouira en fin d’album, mais son côté shoegaze se veut plutôt aérien et vaporeux, davantage dans la lignée de Slowdive que celle des albums Nowhere (1990) et Going Blank Again (1992).
À la place, le quatuor s’abreuve à toute une série d’influences qui, on le devine, sont celles qui les animaient quand ils ont formé Ride en 1988, alors que le shoegaze n’en était qu’à ses balbutiements. Ça démarre avec Peace Sign, une des chansons les plus entraînantes du répertoire du groupe, portée par une ligne de basse d’inspiration post-punk et des claviers qui évoquent immédiatement New Order. L’influence new wave est également très présente sur Monaco, qui étonne avec sa batterie électronique, mais qui a le mérite de transporter le quatuor dans une nouvelle direction.
Après avoir travaillé avec le DJ et réalisateur Erol Ekan sur ses deux plus récents albums, Ride a retenu cette fois les services de Richie Kennedy, dont le curriculum vitae inclut des collaborations avec des groupes comme Interpol, Suede et Fontaines D.C., Kennedy fait un très bon travail ici pour mettre davantage en valeur l’excellente section rythmique formée du batteur Loz Colbert et du bassiste Steve Queralt. L’intro de Last Frontier évoque le mur de son épais qui caractérisait la formation anglaise à ses débuts (on pense à Dreams Burn Down, de l’album Nowhere). Il y a également la puissante montée d’intensité en deuxième partie de Light in a Quiet Room ou encore la lourde Portland Rocks, avec sa batterie et ses guitares rugissantes.
La qualité des textes n’a jamais été le principal point fort de Ride mais Interplay évite généralement les vers creux et les rimes faciles qui atténuent parfois la portée de leur message. Bien sûr, le refrain de Peace Sign ne passera pas à l’histoire (« Give me a peace sign / Throw your hands in the air / Give me a peace sign / Let me know you’re there »), mais le groupe touche la cible quand il aborde le climat morose actuel dans le contexte d’une économie qui favorise toujours les mieux nantis, comme sur Sunrise Chaser :
Round ‘n’ round ‘n’ round we go
— Sunrise Chaser
Steam rolled into cracks we’ve grown
Awakening robbed by treachery
A signature of shameless greed
Près de 35 ans après la parution de leur premier album, les gars de Ride ne semblent pas vouloir vieillir. Il se dégage d’ailleurs de ce septième disque en carrière une belle naïveté, alors que le groupe semble avoir pris plaisir à éviter les clins d’œil appuyés à son passé. Ça ne fonctionne pas toujours, et il y a quelques temps morts au fil de ce long voyage de près d’une heure (l’ennuyante Stay Free ou la banale I Came to See the Wreck, qui sonne comme un pastiche de Depeche Mode). Mais dans l’ensemble, il s’agit d’un retour en forme apprécié pour les vétérans du shoegaze.